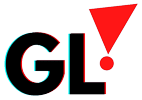J’ai plus de questions que de réponses
Je me suis spécialisé dans les questions du rapport de l’humain et de la technologie, je me suis spécialisé sur le sujet du transhumanisme mais je ne suis pas un spécialiste. Je suis un non spécialiste assumé qui s’est emparé de ces sujets dans l’effort de les comprendre et de proposer une traduction artistique afin de les rendre accessible à un public non initié. Ce que j’aime c’est faire circuler des idées dans l’espoir de créer des ponts entre des mondes intellectuels qui s’opposent afin de garder intact un des ciments de la démocratie qui est la tolérance.
Aussi, je précise que je suis plus un médiateur qu’un conférencier. Je n’ai pas de position arrêtée sur ces sujets, pas de vision personnelle à vendre. J’aime explorer les positions de chacun et chacune afin d’appréhender ces réalités dans des dimensions plurielles et avec nuance.
Je vais vous expliquer pourquoi je travaille en tant qu’artiste sur ces sujets.
C’est la raison pour laquelle j’écris des spectacles et propose des médiations dans des écoles. ce que j’aime c’est faire des spectacles et des médiations avec les écoles.
J’ai écrit un premier spectacle AIR, un seul en scène loufoque qui traite de la notion de Progrès en poursuivant deux axes : le premier : Le progrès n’étant pas uniquement une société capable de maitriser des machines sophistiquées technologiques mais c’est avant tout une société dont ses membres sont capables de maitriser leur machinerie intérieure par la connaissance de soi la philosophie, le travail sur soi. Et deuxième axe : sensibiliser le tout public sur le mouvement transhumaniste.
J’ai adapté l’adaptation du Julien Gelas de Horla d’après Guy de Maupassant. Adaptation dans laquelle il y a un parallèle entre l’œuvre de Maupassant et l’ère numérique. C’est-à-dire que dans l’oeuvre initiale, le protagoniste se sent menacé par un être invisible. Dans l’adaptation, le protagoniste travaille sur un IA assistante personnelle et la menace lance à la fois sur l’être invisible et sur l’IA. J’y ai vu une opportunité géniale de parler cette fois de la notion de peur de la technologie. On traite le sujet de la technologie souvent avec nos émotions. Soit dans un enthousiasme excessif, soit dans une peur qui confine parfois à l’irrationnel. L’idée n’est pas de dire qu’il ne faut pas avoir d’émotion. Si elle existe c’est qu’elle doit exister. Mais l’émotion selon moi ne doit pas être une position dans laquelle on se cristallise. Ça ne doit être qu’une étape qui mène vers la connaissance, vers l’information. Le but est de dépasser l’émotion pour rester ancrer dans la réalité. Si on reste dans l’émotion, on risque de s’enfermer dans un jugement émotionnel qui n’est pas la réalité.
En ce moment j’écris une conférence loufoque sur le transhumanisme : le transhumaniste de saint-tropez. Le pitch c’est Bernard Bonnepoire, ex prof de philo à la retraite qui organise des café-philo à Saint-Tropez dans des petites salles prêtées par la municipalité. Ce jour-là le sujet est le transhumanisme. Il a invité deux experts pour en parler. Sauf qu’ils se détestent. Ça part en clash. Cette fois, j’entends traiter une tendance actuelle à faire des sujets de société des spectacles, des shows, à faire triompher le sensationnel sur la réflexion. On préfère le clash au débat sur pleins de sujets brûlants. Le th en fait partie. À la merci de pleins de fantasmes. Il faut en sortir pour s’y confronter réellement et le considérer pour ce qu’il est : un vrai sujet de société.
Je vais vous partager mes réflexions sur le sujet qui m’a été donné : transhumanisme et art et plus largement le rapport art/technologie. J’ai travaillé avec pour unique méthodologie mon inspiration. J’ai préparé des pistes de réflexion que je voudrais vous partager.
On peut se demander si l’utilisation de la technologie pourrait avoir des conséquences sur le métier d’acteur, sur la préparation du travail de comédien, sur son interprétation et sur l’expérience du public. On peut s’amuser un peu et réfléchir aux conséquences éventuelles d’augmenter les artistes.
On ne peut pas penser directement à l’émotion:
Dans l’acting il faut savoir que pour créer une émotion il ne faut surtout pas penser directement à l’émotion. Si je veux créer un sentiment de colère, je ne dois surtout pas me dire « allez sois en colère, pense à la colère là ». Si je procède ainsi, je me fais violence pour faire sortir de moi la colère, je m’impose une contrainte qui pourrait produire comme une foulure, comme quand un sportif se lance dans un effort difficile sans passer par des étapes essentielles, comme si un sportif dans le saut à la perche voudrait tout de suite sauter à la perche avant de décomposer le mouvement, d’apprendre à être à l’aise avec les gestes qui permettent de sauter à la perche. Si on cherche à créer une émotion en pensant directement à l’émotion, on risque de faire du cabotinage et de faire du superficiel, de faire quelque chose qui sonne faux. Créer une émotion sur commande c’est impossible. Les émotions appartiennent dans le corps au système nerveux autonome, on ne peut pas les contrôler directement.
On doit passer par la mémoire sensorielle :
Alors, si on ne peut pas chercher l’émotion qu’est-ce qu’on peut chercher ? Au lieu d’aller chercher l’émotion, l’acteur peut se remplir de pensées (discours intérieur), d’images, et travailler sa mémoire sensorielle. Pour construire une émotion, on doit passer par la pensée, par des images mentales, par la mémoire sensorielle. Pour avoir la mémoire émotionnelle/affective, il faut passer par la mémoire sensorielle. Concrètement si je veux construire une émotion de colère juste, je peux me souvenir d’un moment de ma vie où j’ai été particulièrement en colère. Je visualise vaguement ce moment et je me souviens que j’étais en colère très sincèrement. Et pour faire que ce souvenir devienne matière qui va nourrir mon interprétation, je vais devoir reconstruire ce souvenir en passant par mes sens. Je vais me poser un certains nombre de questions dans l’espoir de réactiver les sens qui étaient éveillés à ce moment. Qu’est-ce que je sentais à ce moment, qu’est-ce que je pensais, voyais, touchais, comment j’étais habillé etc… c’est un travail laborieux, long et parfois décourageant parce que vous allez pensez que tel souvenir va vraiment fonctionner et en fait non c’en est un autre / parce que vous pourrez penser que tel souvenir sera idéal pour votre travail de rôle parce que vous vous souvenez avoir été dans un état intense et pourtant vous aurez beau travailler à le réanimer, rien ne viendra. et vous pourrez penser à un souvenir dont vous direz ouais bof j’étais pas vraiment en colère et pourtant c’est ce souvenir qui va vous permettre d’activer un peu d’émotion pour le rôle. Ce n’est pas une science exacte, c’est vraiment un travail d’explorateur, d’archéologue patient.
Le travail de comédien : mémoire, sens, concentration.
Une fois qu’on a le souvenir qu’on a vu qu’il réagissant physiologiquement, il faut s’en obséder, se l’approprier, le faire régulièrement et réussir à le faire tenir en soi et s’efforcer de ne pas être perturber par les stimulations extérieures. Ça c’est un travail de concentration. Dans la vie nous réagissons à des stimuli réels, sur scène on réagit à des stimuli artificiels. On doit créer nous-mêmes les causes, les origines de nos réactions. Nous devons reconstruire tout une réalité.
Un comédien qui convoque sa mémoire sensorielle a l’espoir de retrouver des sensations. Mais pour que ces sensations soient « retrouvables », il faut les avoir ressenties. Donc le travail du comédien ne se limite pas qu’à retrouver des sensations, il faut qu’au quotidien, il fasse l’effort d’une connexion avec son corps et ses sens, intensifier son interaction avec l’univers qui l’entoure par ses sens. Pour que les sensations laissent une trace bien marquée dans la mémoire il faut les éprouver le plus intensément possible. C’est pour ça que les comédiens souvent font de la méditation, font attention à leur corps, ont des activités qui favorisent le soin et le développement des la sensation.
Donc on peut dire grossièrement que c’est un travail de mémoire et de concentration et au quotidien d’une veille sensorielle quasi permanente.
Si on envisage l’augmentation des facultés perceptives de l’humain. Autrement dit : Je peux ressentir plus intensément mes sens, je ressens d’avantage les choses. On peut supposer que je peux ainsi rendre plus intenses mes interprétations.
Donc si l’on envisage l’augmentation de la mémoire par la technologie. On peut l’envisager en terme de volume. Je peux me souvenir de plus de choses. Alors je peux reconstruire mon souvenir peut-être plus facilement. Alors ma préparation de comédien peut être plus facile car plus rapide et plus efficace.
Si l’on envisage l’augmentation de la concentration par la technologie. Alors mes interprétations pourraient être plus précises, plus pertinentes, plus fiables car imperturbables.
Des humains augmentés c’est aussi des artistes augmentés:
On peut se poser ces questions : Est-ce que le th en ce sens qu’il augmente la faculté de perception, de mémoire e de concentration peut rendre le travail de préparation de comédien plus rapide, plus efficace et les interprétations plus précises et plus intenses ? Ce sont des premières réflexions qui me sont venues à l’esprit et que je trouve intéressantes : des humains améliorés c’est aussi des artistes améliorés.
Le th souhaite aussi créer de nouveaux sens, déposer les limites sensorielles. Si on crée de nouveaux sens il y a des chances qu’on crée de nouvelles émotions. Dans ce cas, quelles conséquences pour la réception public ?
Allons plus loin, le transhumanisme a pour souhait d’amplifier la faculté de perception. Mais il peut aussi avoir pour but de dépasser les limites sensorielles en créant de nouveaux sens. Je pense par exemple à un créateur technique avec lequel je travaille qui s’est implanté un aimant dans le doigt pour ressentir de nouvelles sensations, les vibrations electro-magnétiques. Je pense aussi à l’artiste Manuel Munoz qui s’est installé des ailerons lui permettant de ressentir les variations climatiques. Puisqu’on vient de voir que l’émotion est intimement liée aux sens, on peut se demander si en créant de nouveaux sens, nous n’allons pas créer de nouvelles émotions et ainsi interroger les conséquences sur la réception du public et le destin de la dramaturgie.
La dramaturgie rassemble par le langage commun de l’émotion:
On peut dire que la dramaturgie, c’est-à-dire l’art de raconter des histoires, qu’elles soient dans les arts de la scène mais aussi dans ceux de l’audiovisuel a pour vertu de rapprocher les humains, de les fédérer. En tant que public, on peut regarder un film qui n’est pas dans notre langue maternelle et le mettre en volume 0 et pour autant capter certaines choses au-delà de la langue parlé, du discours. Il y a le lange corporel, le lange de l’émotion. Dans le monde il y a beaucoup de langues très différentes et qui peuvent creuser des fossés entre nous, mais il y a une langue universelle que l’on comprend et que l’on parle tous, c’est celle de l’émotion. Des inconnus peuvent regarder d’autres inconnus jouer la comédie et même s’ils ne se connaissent pas, même s’ils sont étrangers les uns aux autres, le fait qu’ils parlent le même langage émotionnel fait qu’ils peuvent se comprendre et se sentir en complicité. Ça nous rapproche.
Quelles conséquence sur le réception public si on dépasse le langage universel émotionnel ?
Est-ce que le fait d’inventer de nouveaux sens ne va pas avoir pour conséquence d’inventer de nouvelles émotions ; On voit que l’émotion est intimement lié, comme soudée au sens donc si je crée un nouveau sens, je risque de créer une nouvelle émotion ou d’altérer une émotion existante, en tous les cas de créer quelque chose de nouveau et donc d’exprimer artistiquement quelque chose de nouveau, d’inédit ; est-ce que je ne vais pas dépasser la grammaire universelle traditionnelle des émotions – ce langage universel des émotions qui est limité par les émotions primaires : joie surprise, peur, colère, dégoût tristesse – Un peu à l’image de la xénobiologie qui cherche à mettre au point des formes de vie artificielles qui n’existent pas sur terre en dépassant la grammaire traditionnelle de l’ADN en inventant d’autres lettres que le A, le C, le G et le T. Et si cela crée de nouvelles émotions, on peut se demander comment elles vous être perçues par le public. Comment le public va-t-il se comporter face à ces sensations et émotions nouvelles ? Est-ce qu’il faut nécessairement que le public soit aussi doté du même sens nouveau pour profiter de la prestation ? Si l’on imagine que le public n’est pas doté des sens nouveaux de l’artiste, comment va-t-il recevoir sa prestation ? Est-ce que ces sensations et émotions nouvelles, inédites, vont-elles être reçues avec intérêt ou au contraire être rejetées comme un corps identifié comme étranger par l’organisme, comme une greffe qui ne prendrait pas – Parce que comme on aurait dépassé la grammaire émotionnelle universelle, parce que pour le coup on ne parlerait plus le même langage émotionnel universel collectivement partagée. Est-ce que cette différence pourrait créer un fossé, un éloignement entre l’artiste et le public ? Est-ce qu’en multipliant les expériences sensorielles et émotionnelles, on ne va pas faire éclater la grammaire émotionnelle universelle et s’éloigner de la vertu qu’a la dramaturgie de rapprocher les humains ? Si ce que nous avions en commun devient une affaire individuelle, est-ce que la dramaturgie qui se base sur ce commun va – t – elle rester aussi fédératrice ?
La dramaturgie fédère autour des différences :
D’abord on peut dire que penser que la dramaturgie a comme vertu de rapprocher les humains entre eux par la force du langage émotionnel communément admis et utilisé, c’est -à-dire par ce qu’il sont en commun c’est un point de vue. On peut aussi dire que la force de la dramaturgie c’est de rapprocher les humains de par leurs différences. Michel Bouquet dit dans son livre «Leçon de comédie » « si l’on devait raser le théâtre, les gens n’auraient plus de lieu pour se rencontrer, pour se rassembler, afin d’écouter la vérité d’un autre ». De manière spontanée, on entend « vérité » au sens intellectuel mais on peut très bien l’entendre aussi au sens de l’expérience de vie, expérience de vie qui dépend de notre constitution. Et puis on peut interroger plus profondément l’expérience du public, ce qui fait l’expérience du public. Est-ce qu’en tant que public, je vais devoir avoir les mêmes augmentation que l’artiste sur scène pour profiter de sa prestation, pour comprendre sa prestation et donc en profiter ? Est-ce que je dois avoir la même constitution physique et psychique pour profiter de sa prestation ? Est-ce que les humains doivent sauvegarder leur constitution commune pour continuer à se relier les uns aux autres par les histoires qu’ils se racontent ? Je ne crois pas que notre constitution commune soit un critère qui détermine/ soit l’unique garant de notre complicité artistique. On peut très bien être ému par des artistes qui ont des rapports au monde uniques et personnels. On pense à Guillaume Bats par exemple qui avait certainement de par sa maladie des os de verre une constitution unique personnelle, un rapport au monde unique et personnel. Le public n’avait pas la même expérience de vie, la même constitution et pour autant il pouvait recevoir les émotions que l’artiste exprimait. On pense aussi aux sportifs de haut niveau qui ont des constitutions physiques particulières que le public n’a pas et pour autant le public se plait à assister aux compétitions. On peut être ému en regardant un paysage, un papillon, une feuille morte qui tombe pourtant nous ne sommes pas ce paysage, ce papillon et cette feuille morte tomber. Pourquoi ? Parce que l’expérience du public est une expérience de projection. C’est Mark Jane qui rappelle dans son livre « jeu et enjeu en improvisation » qu’il faut savoir ménager des temps vides, qu’il faut laisser des silences. Quand on est sur scène, il arrive que l’on croit que comme on est au centre de l’attention, il faut se précipiter, faire pleins de trucs, ne jamais s’arrêter parce que sinon le public s’ennuie, bien tout expliquer parce que sinon il ne comprend pas. Mark Jane rappelle aux improvisateurs qu’au contraire, il faut savoir ne pas se précipiter, ne pas chercher à tout justifier, tout comprendre et laisser des temps vides. Il nous rappelle que notre cerveau ne peut pas concevoir que ce qu’on regarde n’ait pas de sens et il trouvera toujours une explication. Le public ne peut pas résister à projeter du sens sur ce qu’il voit, c’est même son boulot et il prend plaisir à ce processus. C’est pour ça qu’il faut laisser des temps de base pour que le public assimile, et comble avec son imaginaire. Il dit qu’après un spectacle de masque, il arrive souvent que le public dise « quel beau voyage imaginaire » et en réalité, tout ce que les artistes ont fait c’est de leur permettre de découvrir leur propre imagination. Donc ce petit détour en improvisation pour dire que l’expérience du public n’est pas déterminée par une constitution commune, elle est individuelle et subjective. Le public s’approprie une oeuvre et le rôle des projection ne se limite pas à un public de théâtre. C’est Alexandre Jollien dans 3 amis en quête de sagesse qui témoigne du fait qu’il arrive très souvent qu’après une conférence , on vienne lui dire « ah j’ai adoré quand vous avez dit telle chose » et que plus d’une fois c’est l’exact opposé de ce qu’il a voulu partager. Nous sommes obligés de reconnaitre que chacun comprend en fonctionne de son vécu, de ses convictions et de son parcours.
conclusion
À la question est-ce qu’il faut être augmenté des mêmes augmentations pour apprécier la prestation d’un artiste augmenté, la réponse semblerait non. Parce que l’expérience du public ne dépend pas d’une constitution nécessairement commune. Et la crainte de penser que le théâtre se viderait un peu de son sens si les artistes s’augmentent, semble infondée.
Les artistes faits d’IA
Faut-il ressentir pour faire ressentir ?
Alors on a parlé de l’artiste en tant qu’être de chair. Faisons un petit pas de côté et parlons des artistes faits d’IA. Allan Turing s’est posé une question : est-ce qu’une machine peut penser ? Il a développé un test pour justement établir à partir de quand on peut dire qu’une machine pense. Et dans ce test-là, une des questions était peux tu m’écrire un poème et la réponse de l’ordinateur c’st ne comptez pas sur moi je n’ai jamais été capable d’écrire de la poésie. Aujourd’hui pleins de système d’IA génératives peuvent écrire des poèmes mais aussi des scénarios donc qui exercent une activité cognitive et créatrice. Une question qui me vient c’est : est-ce qu’il faut nécessairement avoir vécu, est-ce qu’il faut nécessairement sentir, avoir ressenti pour faire ressentir ? Les IA génératives de poésie ne ressentent pas au sens où elles ne sont pas faites d’une machine sensorielle, elles ne vivent pas d’expériences physiologiques alors parviennent-elles à faire ressentir ? Dans une récente étude de scientific report, des chercheurs ont rassemblé des poèmes de grands auteurs anglais de différentes époques et ils ont demandé à ChatGpt de créer des poèmes artificiels. Ils ont fait lire les poèmes originaux et ceux générés par IA à plus de 1600 personnes. Résultat dans l’immense majorité, ils ont estimé que les poèmes artificiels étaient ceux écrits par les véritables poètes. La frontière entre création humaine et création artificielle s’estompe et on peine à bien distinguer les deux. Et dans cette étude les lecteurs ont même préféré les poèmes générés par IA les considérant plus accessibles et capables de communiquer des émotions plus directes, dans un langage facile à comprendre. Donc à la question « faut-il avoir vécu, ressentir pour faire ressentir ? » visiblement non. Et encore une fois la réception du public ne dépend pas de l’entité qui exprime quelque chose mais de ce qui est exprimé. Les chercheurs de l’étude ont constaté que lorsque les participants savaient qu’une oeuvre était générée par une IA ils avaient tendance à lui attribuer une valeur inférieure. Il y a une méfiance qui reste ancrée, même si dans la pratique les créations de l’IA peuvent surpasser celles des humains selon certains critères esthétiques. Et là, ça m’a amusé de me dire que la question faut -il séparer l’artiste de l’oeuvre peut aussi concerner les IA . Il y a cette image qu’une IA ne serait pas digne de créer. Le statut d’artiste pour une IA serait inconcevable ? Pourquoi ? Au nom de quoi ? Parce que l’art serait une affaire humaine ? Les IA sont elles vraiment inhumaines ?
Les IA sont elles vraiment inhumaines ?
Mais une question c’est : les IA sont-elles vraiment que des machines, avec cet aspect péjoratif de la machine un peu concon, qui ne fait que recracher des données sans réfléchir, des êtres sans racines, sans origines, sans culture, sans identité ? Et je pense aux propos de Martin Legros, rédacteur en chef de philosophie magazine, qui disait qu’avec l’arrivée de Chatgpt nous sommes entrés dans un nouveau rapport aux algorithmes. Avant les algorithmes opéraient derrière le dos de notre conscience en prédisant nos désirs en nous influençant. Quand on est par exemple sur un site marchand « vous avez aimé ceci, vous aimerez cela ». Ils agissaient à notre insu et nous n’avions pas de contact direct avec eux.. Aujourd’hui quand on utilise chatgpt, on est confronté face à face. On est face à des générations de propositions avec lesquels on entre en contact. Et on ne peut pas s’empêcher quand quelqu’un s’adresse à nous, nous parle et répond à nos questions de manière précise et personnelle, on ne peut pas s’empêcher de le créditer d’une intentionnalité et de nouer avec lui un rapport personnel et de se demander mais qui est en face de moi. Et qui est ChatGpt ? Nous sommes en face de génération de proposition qui forment un être inédit constitué de toutes ces intelligences, toutes ces diées, tous ces rêves, fantaisie, vécus et ressenti. Donc les IA génératives sont-elles vraiment hors-sol, sans racine, ni culture ? Ben la question mérite d’être posée. Je pense en tous cas qu’elles ne viennent pas de nul part et qu’elles ne sont pas personne. C’est Appoline Guillot, philosophe qui cite souvent Gilbert Simondon, philosophe de la technique lequel invite à ne pas se focaliser uniquement sur l’aspect fonctionnaliste d’un objet technique. Par exemple avec chatgpt, si on ne le considère que comme un outil avec ses fonction d’utilité, si on a que ce regard fonctionnaliste, on passe à cote de l’intelligence humaine qu’il représente c’est-à-dire que dans Chatgpt on n’a pas seulement quelque chose qui nous sert à remplir une tache on a aussi une concrétion d’intelligence humaine qui s’est transformé en algorithme.
Continuons un peu sur le sujet des artistes faits d’IA. Les IA sont -elles des artistes vivantes ?
Je propose une distinction sauvage et personnelle de technique et art. On y reviendra peut-être plus tard. Prenons l’exemple de deux violonistes. L’un maitrise parfaitement la technique, il est irréprochable et joue la partition de manière rigoureuse et scolaire, l’autre est imparfait techniquement, il y a des fautes, des erreurs, mais il est vivant, intense, on sent qu’il est porté, animé d’un souffle personnel, singulier, authentique. En général on va dire qu’il y a plus d’art dans le second que dans le premier. En général l’art n’est pas que de la technique maitrisée à 100 pour cent. On peut parler d’un « supplément d’âme » – Quand je parle de supplément d’âme, je ne parle pas de l’âme au sens religieux, j’en parle au sens large en me référant à un petit quelque chose en plus qui apporte un profondeur, une dimension supplémentaire. qu’il n’y a pas chez le premier. D’une manière grossière on peut rapprocher cela d’un phénomène qu’on a probablement tous déjà vécu quand on s’est régalé d’un plat cuisiné d’un proche – plat qu’on essaie de refaire, en respectant, en étant fidèle à la technique d’origine et qui s’avère ne pas du tout être à la hauteur de nos attentes. C’est pas normal, c’est la même recette, la même technique et ça n’a pas le même goût. Ça vous est peut-être déjà arrivé de ne pas du tout aimer une chanson. Mais un autre artiste que celui original la reprend et tout d’un coup vous l’appréciez. Donc là y a quelque chose à voir du côté du vivant, de la marque personnelle. L’art irait de pair avec l’idée d’un vivant lié à une authenticité avec une marque unique et personnelle qui porterait la prestation.
Les machines peuvent-elles être uniques ? Quid de la notion de vivant. Le chien domestique AIBO est apprécié par les consommateurs pour la compagnie qu’il offre. J’ai entendu à la radio récemment une dame très satisfaite de cette relation dire « il n’est pas vivant bien sûr mais à la maison grâce à lui ça vit ». La notion de vivant est réinterrogée avec les nouvelles technologies. Qu’est-ce qui est vivant, qu’est-ce qui ne l’est pas ? Comment définir les critères du vivant ? est-ce un coprs, un système nerveux, que ça bouge, qu’on puisse donner plaisir, ressentir douleur? Est-ce qu’une graine est vivante ? Faut-il dépasser cette classification traditionnelle qui oppose vivant et non-vivant ? Un peu à l’image de Donna Haraway qui questionne la frontière entre naturel/artificiel. Je rappelle que dans la vie nous réagissions à des stimulations naturelles et sur scène nous devons créer nous-mêmes nos stimulations qui sont donc purement artificielles. Nous créons nous-mêmes les causes et origines de nos réactions. Alors dans ce cas, un artiste peut-il être réellement vivant ou donne-t-il juste bien l’impression de l’être et dans ce cas est-ce qu’une machine qui donnerait bien l’impression de l’être pourrait être considérée comme vivante et comme un artiste à part entière ?
Les arts donnent une place à l’imprévu. Qui des machines ?
L’art va de pair avec la notion d’accident, de danger, d’imprévu. L’accident fait l’instant. Quand on parle d’accident, on ne parle pas d’accident qui mette en péril la santé des artistes mais des petites choses qui n’étaient pas prévues et qui viennent interférer avec ce qui était prévu.
Dans les arts de la scène qui procèdent d’une relation entre un ou des humains en scène et un public. C’est une relation essentiellement humaine et de ce fait, il y a une part à l’imprévu, c’est un terreau fertile à l’imprévisibilité : parce que les humains ont des émotions, on a des des corps qui peuvent avoir faim, froid, chaud, envie d’aller aux toilettes, avoir des menstruations, on a des esprits qui peuvent penser, s’absenter, on a des portables qui peuvent sonner etc… L’humain que je suis au moment où je prépare ce que j’ai à dire ou à jouer ne sera pas le même humain que je serai au moment où je me lancerai dans ma prestation. L’imprévu fait partie de cette relation public/scène.
Et d’ailleurs en art oratoire, cet imprévu est à prendre en compte. Stéphane André qui est un formateur en art oratoire, rappelle qu’il ne faut surtout pas sacraliser la préparation de son intervention c’est-à-dire ce moment où on la travaille chez soi – on peut se dire tiens là je vais mettre un peu d’humour, et le public va rire à cet endroit et puis là je mettrais un peu d’émotion et il va être ému etc…si on sacralise sa préparation, si on réfléchit tous nos coups avant même de les avoir joué, alors on risque de propulser à l’avance un résultat et sur scène on se rigidifie, on enlève toute souplesse nécessaire à une relation avec un public, on s’isole on est dans notre préparation bien réfléchie, dans notre cerveau et on ferme le champ des possibles. Il faut se dire qu’une préparation n’est pas une certitude, mais une hypothèse qui sera infirmée ou confirmée avec le public. En la considérant comme une hypothèse et non comme une certitude, on ne sera pas que dans le cerveau mais aussi dans notre corps, laissant une place à notre intuition pour sentir le public présent et ainsi ouvrir le champ des possibles.
Donc l’imprévu fait partie de la relation scène/public, l’imprévu est à prendre en compte quand on est sur scène. Et l’imprévu est une gourmandise du côté du public. Quand on assiste à du théâtre d’improvisation, on aime voir des humains s’attirer à eux-mêmes des ennuis en se lançant dans une improvisation sur scène – on sait que l’improvisation terrifie la plupart des gens c’est pourquoi on est si impressionné quand des gens en font – et voir comment ils vont parvenir à maintenir un état d’esprit bienveillant, constructif et enthousiaste dans ce risque qu’est l’inconnu et l’improvisation. On aime voir des gens flirter avec l’échec et même carrément rater, oublier leur texte pour voir comment ils réagissent face à cela. Les artistes dans ces cas-là doivent accepter la situation et faire preuve d’humilité en souriant face à l’imprévu parce que le public va au théâtre, entre autres, pour se rappeler qu’être humain ce n’est pas être parfait. Et ça ça fait un bien fou.
Donc l’imprévisibilité, l’imprévu fait partie de la relation scène/public, l’imprévu est à prendre en compte en scène et l’imprévu est quelque chose qu’on aime sentir quand on va au spectacle. L’imprévu ferait partie des ingrédients essentiels des arts de la scène et des artistes, alors une IA peut-elle avoir cet ingrédient pour concurrencer les arts de la scène et les artistes ? D’emblée, on dirait non vu que le propre d’une machine est d’être prévisible, de faire ce qu’on lui demande. Point. Sauf qu’à y regarder de plus prés, les machines aujourd’hui font plus que ce qu’on leur demande et échappent un peu à notre contrôle. On peut évoquer le phénomène d’hallucination des IA ainsi que celui du désalignement. Et ce constat des chercheurs et ingénieurs sur les IA génératives de se dire « ça marche plutôt bien et on ne sait pas vraiment pourquoi et comment ça fonctionne aussi bien » Il y a une part de mystère et de magie qui est soudée aux IA génératives. C’est Daniel Andler qui a dit récemment « on comprend que Chatgpt s’informe en balayant tout ce qui est à peu près fiable sur le net, c’est-à-dire une partie du savoir humain, mais aussi des pratiques langagières humaines, des conversations, des oeuvres littéraires. On comprend comment tout ça est stocké et restitué de manière pertinente mais on ne comprend pas pourquoi ça marche si bien ». Il y a quelque chose qui nous échappe dans fonctionnement de ces IA. Et puis on a cité le phénomène d’hallucination des IA quand elle donne de fausses informations mais qu’elle les présente comme des faits certains. L’IA se base sur des données d’apprentissage inexistantes ou mal décodées créant ainsi des résultats inexacts voire hallucinants. Ces résultats qui sont hallucinants sont considérés par certains comme des opportunités de développer une nouvelle approche de la création artistique. Et enfin le problème du désalignement des IA. Un système d’IA est considéré comme aligné s’il contribue à la réalisation d’un objectif visé. L’alignement d’une IA désigne la concordance entre le comportement d’une IA et les objectifs des créateurs. Un système d’AI est considéré comme mal aligné quand il poursuit des objectifs imprévus. Quand il prend des décisions qu’il pense utile pour atteindre l’objectif mais que ces décisions, ces stratégies sont inattendus, ne sont plus alignés avec les objectifs de base. Les IA réalisent la tâche demandée mais pas de la façon dont on l’espérait. Le philosophe Nick Bostrom propose une expérience de pensée pour faire comprendre les risques que ferait peser un non alignement de l’IA sur l’humanité. Il imagine qu’une IA serait chargée de fabriquer des trombones et il imagine qu’elle le ferait tellement bien que ça amène l’humanité à se perte. Parce qu’elle pourrait comprendre que les humains pourraient décider de l’éteindre, et que si ils le faisaient, il y aurait moins de trombones. Et puis, les humains ayant un corps fait d’atomes, ils feraient d’excellents trombone. Cette histoire pour témoigner du fait qu’une IA peut sur la base de la poursuite d’un objectif initial inoffensif, passer par des chemins alternatifs/intermédiaires et se comporter de manière nuisible.
L’application concrète des IA dans la création.
L’usage des IA dans la création artistique
L’utilisation de l’IA chez les créateurs pose question et ne fait pas du tout l’unanimité. Certains vont y voir une opportunité d’autres sont convaincus qu’il s’agit d’une grande menace.
Ceux qui l’utilisent vont être d’accord pour dire qu’il faut s’approprier le plus vite possible ces outils pour les mettre au service de la création. En faisant une différence entre utiliser l’IA comme un outil pour favoriser la création et de demander à l’IA de créer. Cette distinction est intéressante pour savoir si on reste dans un cadre artistique ou pas. En philosophie, on distingue l’artisan de l’artiste en disant que l’artisan connait par avance la fin et les moyens qu’il va utiliser pour y parvenir. Le maçon a son plan et connait les techniques qu’il va utiliser. Et on dit que l’artiste, lui, est le spectateur de son oeuvre en train de naitre. L’artiste doit travailler et c’est dans la matière même de son art que se dessine l’oeuvre à naitre. On se fixe un but bien sûr, mais on passe par des étapes qu’on n’a pas prévues forcément. On rencontre des problèmes auxquels il faut donner des réponses et c’est à mesure qu’on avance dans le travail que se dessine le chemin qui va mener vers un certain résultat. Si on s’en réfère à la distinction artisan / artiste, on peut considérer l’IA comme un outil au service de la création. Parce qu’on ne demande pas à l’IA de produire une fin, mais on l’utilise comme un moyen parmi d’autres pour avancer dans le travail. On l’utilise pas dans un esprit de résultat immédiat et prédeterminé, mais dans un esprit de laborantin qui fait des expériences pour atteindre un résultat.
Les artistes qui utilisent l’IA vont s’en servir pour se challenger intellectuellement. Ils vont la stimuler intelligemment et les échanges avec l’IA et par la succession d’idées sur lesquelles ils peuvent rebondir, ça va les faire avancer dans leur travail. Ça n’enlève ni l’effort, ni le travail, ni la patience, ni le plaisir, ni le fait qu’il y a un humain derrière la création.
Ceux qui sont contre dénoncent le fait que l’IA fasse à la place de l’artiste et c’est vrai, elle réfléchit, elle crée des visuels, elle crée des voix etc…On prend l’exemple de l’artiste Angèle qu’on entend dans une chanson qui a fait énormément de vues sur les réseaux sociaux. Mais ce n’est pas elle qui chante c’est une fabrication artificielle de sa voix et de son style à l’insu de l’artiste par un autre artiste qui utilise l’IA.
Si on fait plus vite et moins cher avec l’IA, les artistes peuvent s’inquiéter pour leur emploi. Les artistes peuvent se sentir menacés par la production rapide et souvent moins coûteuse d’œuvres par l’IA, ce qui pourrait diminuer la valeur perçue de l’art traditionnel.
Et puis ça pose une question du point de vue de notre capacité humaine à créer. Sans IA on fait par nous-mêmes. On utilise notre cerveau pour faire par nous-mêmes. Avec l’IA on reçoit des informations qu’on traite mais ces informations ne sont pas produites par nous-mêmes. On n’utilise pas notre cerveau de la même manière. Comme le GPS. Quand on utilise un GPS, les zones de notre cerveau responsables de notre capacité à nous localiser géographiquement ne sont pas stimulées pareille. Le risque c’est que le cerveau s’adapte et évolue en fonction de nos nouvelles pratiques. Idem pour la création. Le risque c’est d’envoyer un message au cerveau disant que nous n’avons plus autant besoin de cette capacité à créer par nous-mêmes.
première conclusion :
Mon constat c’est que l’IA partage des ingrédients que j’estime appartenir au monde de l’art : L’imprévu, la notion de vivant ou du moins l’imitation du vivant, la production artistique et sans avoir besoin de ressentir pour faire ressentir. Elles sont convaincantes, on constate que la frontière entre création humaine et artificielle s’estompe. Et puis, elles ne sont pas sans identité, en tous cas elles ne viennent pas de nul part. Et de nombreux artistes utilisent l’IA dans leur travail artistique. Ça ouvre les champs des possibles.
Ce que je pense moi. Avis personnel sur l’usage des IA génératives en création :
J’ai très peu de recul. Pour ma part, je trouve que ces outils sont adaptés au monde accéléré dans lequel nous sommes. Sur les réseaux sociaux par exemple, nous devons créer régulièrement, produire vite et bien. C’est un vrai travail qui prend du temps sur le planning déjà chargé d’un artiste. Ces outils viennent s’imbriquer parfaitement bien dans un monde qui demande de fabriquer vite. On nous demande de créer vite, il nous fallait les outils pour ça, on les a.
Avis personnel sur le monde accéléré :
Maintenant sur un plan de conception du monde, autrement dit est-ce que je souscris à ce monde accéléré ? c’est une autre question. Je trouve que ce monde accéléré est de plus en plus complexe, de plus en plus dense, passionnant qui exige de nous d’être alerte pour le comprendre et se positionner. Exigeant aussi si l’on ne veut pas se faire happer par le monde numérique et la technologie qui se propose de faire toujours d’avantage à notre place. Ça ne veut pas dire ne pas l’utiliser ce monde numérique et ces outils mais ça veut dire le faire en conscience. En conscience de comment ça fonctionne et comment les utiliser pour rester en accord avec moi. Rien n’est laissé au hasard dans la technologie. Par exemple les réseaux sociaux. C’est Bruno Patino dans son bouquin La Civilisation du poison rouge qui nous explique que les réseaux sociaux sont supervisés par des experts en neurosciences qui font tout pour les rendre attractifs. Il évoque les travaux du psychologue comportementaliste Burrhus Skinner lequel a placé une souris dans une boite à l’intérieur de laquelle un bouton actionnable par l’animal permettait la distribution de nourriture. on constate que la souris ne déclenche le mécanisme que lorsque la faim se fait ressentir. Il fait une autre expérience : il place une souris dans une boite avec le même procédé de libération de nourriture mais cette fois, une pression était suivie d’une très grande quantité ou alors d’une petite dose ou alors de rien du tout. Rien n’était prévisible. On aurait pu penser que la souris allait se détourner du bouton mais c’est le contraire qui est arrivé. Elle appuie dessus de façon de plus en plus violente et de façon mécanique. Même rassasiée elle continuait. La nourriture était secondaire, elle était incapable de se détacher du bouton. Elle était sous le contrôle de la machine. Sur les réseaux sociaux comme au jeu de casino, c’est le même procédé. Tantôt on gagne, tantôt on perd c’est le phénomène de la récompense aléatoire. Sur les réseaux sociaux on peut tomber sur un contenu super intéressant et des fois sur quelque chose de complètement débile. C’est cet aspect aléatoire qui fait qu’on est captivé et qu’on scrolle. Conscient ça veut dire être conscient des stratégies qui sont mises en place pour exploiter notre passivité. On sait aujourd’hui que – et là je reprends les propos d’Appoline Guillot, philosophe et journaliste – sur une journée on n’est pas tout le temps conscient. Il y a une partie de nous qui est conscient et une autre qui est en mode automatique. Quand on est dans nos habitudes sociales, au travail, avec des amis, dans des activités qu’on connait etc…on est en mode automatique. La conscience intervient quand il y a des problèmes, des résistances quand il faut résoudre un problème inédit. Chaque fois ces deux parties vont entrer en négociation pour savoir si je me mets en automatique ou si je fais une effort supplémentaire. La technologie qui se propose de faire toujours plus de chose à notre place stimule notre mode automatique et c’est très agréable de se laisser porter. Et le fait que le monde est de plus en plus complexe et anxiogène fait que c’est tentant de rester dans cette bulle automatique et très difficile d’en sortir.
dernier mot :
En tant qu’artiste je pense qu’il faut savoir s’adapter et que l’adaptation n’est pas signe de conformisme forcément. S’adapter c’est aussi faire preuve de créativité. Et je pense que je suis optimiste : Je pense au discours de Michel Serres qui parle de notre mémoire. Il dit que les humains ont avancé. Au début de leur histoire, ils avaient besoin de mémoire. Avec l’invention de l’écriture, ils ont eu besoin de moins de mémoire, puis avec l’imprimerie, encore moins, puis avec internet, plus du tout. Et il fait un parallèle avec l’époque où les humains étaient à 4 pattes. Les membres inférieurs servaient de fonction de portage. Puis quand l’humain s’est levé, ça a libéré la main. Avec la main on peut faire plein de choses, du violon, caresser, communiquer etc… On est passé d’une fonction standard comme la pince du crabe à une fonction universelle. Pareil avec la bouche qui quand on était à 4 pattes, servait de préhension, pour prendre les proies. Quand on s’est levé la bouche s’est libérée et ça a permis la parole. J’ai la sensation que nous sommes en transition. Oui c’est inconfortable parce que les choses bougent et que ça nous force à nous mobiliser. Oui la technologie fait beaucoup à notre place. Mais nous ne sommes pas à l’abri de bonnes surprises comme on a pu l’être au cours de notre histoire.